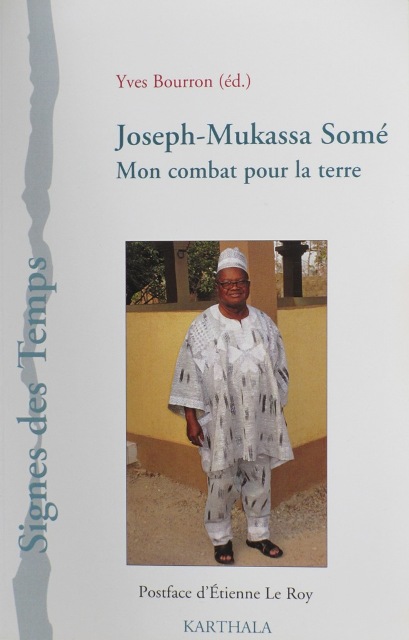En quoi l’itinéraire de Joseph-Mukassa Somé, fils de chef de terres coutumier dagara (Burkina Faso), baptisé et entré au Petit séminaire par hasard, a-t-il quelque chose de particulier pour qu’il devienne, comme le dit Etienne Le Roy dans sa postface, une « figure africaine exemplaire » ? Ce prêtre séjournera par deux fois en France pour y entreprendre des études de sociologie et écrire une thèse de doctorat en anthropologie.
Professeur de sociologie à l’Université Catholique d Abidjan et vice-recteur, il sera choisi par les évêques du Burkina pour réorganiser la politique de développement de son pays en dirigeant l’OCADES (Organisation catholique pour le développement et la solidarité). Toute sa vie, cet anthropologue sera passionné par la défense de la terre, jusqu’ à passer près d’un an au Brésil et y partager la vie de ceux qui luttent pour les « Sans-terres ».
Mukassa témoigne de cette capacité qu’a tout homme, né « quelque part », de donner sens à la nature qui l’environne, aux événements qui traversent sa vie, de la naissance à la mort : aptitude à s inscrire dans une lignée qui permet à chacun de grandir, de procréer et, en mourant, de trouver une place dans la grande chaîne des ancêtres ; croyance en un être suprême dont on procède et dont procède la terre ; recherche tâtonnante de ce que sont le bien et le mal pour chacun et la communauté, avec les rites à respecter afin que celle-ci survive sans se déchirer.
Autant de questions traditionnelles bousculées par d’autres plus contemporaines : comment toute culture s’adapte-t-elle à une mondialisation des idées, poussée qu’elle est par le vent des nouveaux savoirs, des besoins des jeunes, des appétits sans limites des plus grands, des plus riches ? Prenant le relais du sociologue, le prêtre s interroge sur la capacité qu’a l Église à accepter le métissage culturel de chaque peuple, à reconnaître les valeurs de leur système de représentation et de leur être-au-monde. En ce qui concerne la terre, l’héritier mène un combat pour éviter une spoliation opérée par l’État ou des puissances étrangères (landgrabbing).
Son combat, qui n est pas seulement une défense de biens quelconques, prend la forme d une croisade pour que les chefs de terres qui ont reçu ce « don de la terre » sachent faire valoir leurs droits, tout en restant ouverts aux échanges nécessités par le développement.
Ils en parlent…
Il y a dans le récit de vie de l’abbé Mukassa deux thématiques qui s’entrecroisent, comme dans une pièce de musique, l’une concernant sa vie de prêtre de l’église catholique burkinabé et l’autre celle d’héritier d’un lignage de chefs de terres. Chacun des témoignages qu’il apporte dans ces deux registres nous est précieux et le lecteur en fera son miel selon que ses centres d’intérêts le conduiront tantôt vers les questions actuelles de politiques foncières, tantôt vers une histoire plus intime d’une vocation religieuse confrontée aux rudes réalités de la décolonisation du Burkina confronté au sous-développement…
L’abbé Mukassa appartient à la génération des prêtres voltaïques qui ont pris le contrôle d’une Église qui est devenue nationale en 1960 avec l’indépendance de la Haute Volta et qui a ainsi dû se confronter à des pouvoirs politiques et administratifs maintenant contrôlés par des compatriotes et non plus par des colons, des frères, parfois consanguins comme on le relève dans plusieurs moments du récit. Les relations entre les pouvoirs politiques et religieux n’ont pas, depuis, toujours été simples et le coup d’État du capitaine Sankara en 1983 va compliquer singulièrement la donne tant pour l’institution ecclésiale que pour l’abbé Mukassa qui devra s’expatrier quelques temps à Paris. Peut-on concilier le statut d’un prêtre séculier et celui de sorcier, même peu dangereux ? Sans doute oui car l’abbé Mukassa partageait cette position symbolique avec son propre évêque et ni l’un ni l’autre ne s’en souciaient exagérément. Leurs ouailles, par contre, pouvaient devoir prendre quelques précautions quand la symbolique du revenant posait des questions trop provocantes. On sait en effet que la conception du monde privilégiée dans les pensées africaines est liée à une circulation des énergies divines et cosmo-humaines et que les télescopages entre forces contraires sont à éviter, éventuellement par un blindage contre les puissances adverses. Or, on y reviendra, étant aussi par sa position lignagère et comme héritier de son père, chef de terre, et ainsi associé à la sacralité de la terre (sans pouvoir comme prêtre en célébrer les rites agraires) et à sa propre puissance énergétique de der, l’abbé Mukassa mobilise deux forces, de sa lignée et de sa terre, au risque de déplacer ou de rendre floues certaines limites.
Cette position lignagère lui a posé un autre problème, lorsqu’il a pris conscience qu’il était affecté par ce qu’il estime un ethnocide, la perte d’une partie de son identité traditionnelle, ce qui le rend dérangeant pour certains, en particulier pour les plus occidentalisés de ses proches apparentés qui considèrent qu’il s’agit là de ‘vieilles lunes’. L’abbé Mukassa se réclame d’une identité traditionnelle dont il déclare que sa société a été privée lorsque l’ethnologie coloniale a classé les Dagara comme matrilinéaires au détriment d’une patrilinéarité qui lui manque pour des raisons que je ne prétends pas totalement éclaircir. Ce qu’on sait de l’ethnologie coloniale permet de faire correspondre cette catégorisation à ce moment où on pensait, à la suite de quelques anthropologues britanniques, que les systèmes africains de parenté étaient nécessairement unilinéaires. Ce n’est que tardivement qu’on prit conscience qu’une bonne part de ces sociétés relevaient d’une bilinéarité asymétrique, certains pouvoirs ou certaines forces se transmettant par une lignée ou par l’autre. L’abbé Mukassa déclare qu’il a été privé du nom de son père et que donner à un enfant le matronyme c’est l’asservir. Je préférerais appauvrir à asservir car je comprends que, derrière le souci d’associer sa patronymie à sa matronymie officielle, il se sent d’abord riche de l’ensemble de ses positions sociales traditionnelles, ouvrant à une pluralité d’appartenances, donc à une pluralité de solidarités potentielles. On est en effet d’abord riche de ses parents et apparentés et un proverbe wolof qu’on me citait souvent sur mon premier terrain sénégalais rappelait que seul, le roi n’a pas de parents. Il me semble que l’abbé Der Mukassa était sensible à cette pluralité des appartenances et des solidarités quand on lit comment il pouvait mobiliser une autre forme de partage que je tiens pour une dimension constitutive de la conception africaine de la parenté et que la littérature coloniale a eu beaucoup de difficultés à identifier et à caractériser en parlant de parenté à plaisanterie ou à libre parler. On verra, à un moment, ce vieil abbé et une jeune religieuse se réclamer d’une liberté de propos qui transcende les rapports d’âge, de genre et de position ecclésiastique sur la base de relations ontologiques entre les groupes ethniques ou claniques (ici entre Gouin et Dagara), selon des justifications qui relèvent plus souvent du mythe que de l’histoire, ce qui n’enlève rien à la pertinence et à la permanence de l’explication.
Enfin, ses origines familiales auraient pu infléchir son histoire de vie. Fils d’un notable impliqué dans le fonctionnement de l’administration coloniale, l’enfant Mukassa aurait pu avoir une carrière militaire. Il devait en effet partir au prytanée militaire de Saint Louis du Sénégal lorsqu’il en fut détourné par une manœuvre malicieuse d’une religieuse qui lui fit croire que le camion qui passait l’emmènerait au prytanée alors que sa destination était le petit séminaire voisin. La déception fut rude mais, de fil en aiguille, une vocation religieuse émergea puis se confirma et l’image que l’abbé Mukassa nous offre de son engagement de clerc est non seulement d’une grande richesse mais, en outre illustre, comme le remarque également son éditeur Yves Bourron dans sa postface, comment un homme bien né a pu faire coïncider de manière plutôt harmonieuse une vocation sacerdotale, une formation universitaire sanctionnée par un doctorat en anthropologie et sociologie du développement et un poste de vice-recteur de l’UCAO (Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest) d’Abidjan puis un engagement citoyen où il a rencontré, plus souvent que souhaité semble-t-il, le politique.
Extrait de la postface d’Etienne le Roy, (professeur émérite d’anthropologie du droit, Université de Paris 1 Sorbonne).